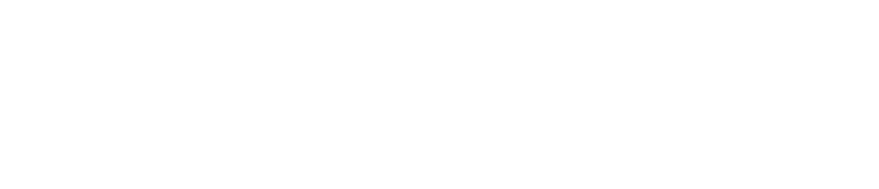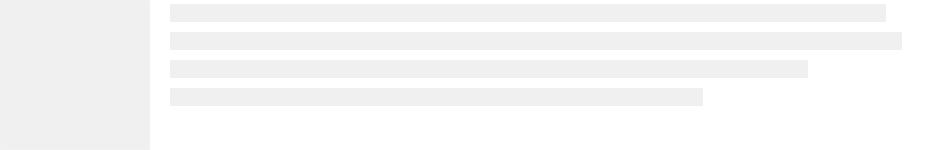À 37 ans, Chloé Freslon est la fondatrice de URelles, un cabinet de conseil dont la mission est de rendre l’industrie technologique plus inclusive et diversifiée. L’entrepreneure et chroniqueuse a fait le constat, quelques années plus tôt, de l’absence des femmes dans ce milieu dont la main-d’œuvre demeure très homogène. Rencontre.
Créée en 2019, URelles est spécialisée dans la stratégie et la mise en œuvre de politiques favorables à l’embauche et la rétention des femmes dans l’industrie technologique. Un processus qui se fait en plusieurs étapes, à savoir attirer les talents féminins dans les structures professionnelles, les retenir, et les aider à se projeter sur le long terme.

Une étude mentionnée sur le site de URelles et publiée par Morgan Stanley en 2017 indique que les entreprises technologiques les plus inclusives ont rapporté en moyenne 5,4 % de plus que les entreprises moins inclusives. «Si tous les employés viennent de la même université, ont grandi au même endroit et ont le même profil, ils vont probablement penser aux mêmes solutions, affirme Chloé Freslon. Quand on prône la diversité, on promeut en fait la différence qui apporte de la créativité et une plus grande capacité de résolution de problèmes.» Lorsque la main d’œuvre est diversifiée, elle s’adresse aussi à un plus grand pan de consommateurs.
Or, les femmes ont souvent besoin d’être convaincues ou rassurées lorsque vient le temps de poser sa candidature à un poste. En cause, on note le statut de minorité des femmes dans un milieu où elles constituent environ 20% de la main-d’œuvre. Cette sous-représentation est à l’origine de dynamismes qui placent souvent des bâtons dans les roues de la vie professionnelle. Selon Mme Freslon, de nombreuses femmes vont ainsi chercher à se faire davantage accepter par leurs pairs masculins en imitant leurs codes vestimentaires voire leur apparence.
Bien légitime, cette quête de visibilité n’est pourtant pas bénéfique. «Cela a des conséquences négatives pour tout le monde, d’abord pour la femme qui ne peut plus être authentique dans le but de fiter dans une case, illustre l’entrepreneure. Et puis ça perpétue des dynamiques de masculinités traditionnelles qui peuvent être toxiques.» Cette représentation standardisée, autant des femmes que des hommes évoluant dans le milieu technologique, est d’ailleurs poussée à l’extrême au cinéma.
«Si tu ne vois personne dont le profil te ressemble et qui a déjà fait cela, tu as souvent du mal à imaginer que le poste est fait pour toi.»
En outre, le manque de modèles féminins qui occupent déjà des emplois dans l’industrie technologique n’aide pas les autres à se projeter dans ce milieu. «Si tu ne vois personne dont le profil te ressemble et qui a déjà fait cela, tu as souvent du mal à imaginer que le poste est fait pour toi», ajoute-t-elle.
Une question de culture
Dans les années 1960, les femmes occupaient davantage des postes de programmeuses sur les software, soit les logiciels et la programmation, tandis que les hommes étaient responsables du hardware, c’est-à-dire du matériel informatique. «Le hardware était vraiment cool à l’époque, quand les ordinateurs étaient immenses, raconte Chloé Freslon. La programmation demandait plutôt de la minutie, de la précision, et il avait été identifié que les secrétaires pouvaient très bien faire ce job-là.»

Plus tard, lorsque l’informatique s’est démocratisée et que travailler sur le matériel informatique est devenu «moins cool», les logiciels et leurs langages de programmation ont attiré davantage la main-d’œuvre masculine. «Les hommes se sont dès lors imposés sur le marché autant du hardware que du software», ajoute-t-elle.
Quand les Personal Computer (PC) sont arrivés, ils ont pris la place des gros ordinateurs, souvent chers et possédés par des corporations ou des centres de recherches. Plus abordables et accessibles aux particuliers, les PC ont été identifiés par les publicitaires comme des jouets destinés aux garçons.
«On ajoute à cela les films sur les hackers, représentant en majorité des hommes, puis le mythe du hacker avec son chandail à capuche dans son sous-sol à faire le mal, image Chloé Freslon. Or, les femmes sont plus attirées vers des domaines où elles peuvent avoir un impact positif comme en éducation et en santé.»
«Je voulais montrer que les femmes en tech existaient, mais qu’elles étaient simplement dans l’ombre des hommes.»
Tous ces facteurs historiques mêlés à des influences culturelles ont mené à sortir progressivement les femmes de l’industrie. Depuis les années 1980, le nombre de femmes détenant un emploi dans l’industrie des technologies n’a ainsi jamais augmenté.
Entourée d’hommes
Née de parents français, Chloé Freslon a grandi à l’étranger, principalement sur le continent africain. Au moment de faire le choix cornélien des études supérieures, l’un des critères les plus importants était de pouvoir continuer à voyager de la même façon que dans son enfance. C’est ainsi qu’elle s’est dirigée vers le domaine de l’hôtellerie, dans lequel elle est travaillée plusieurs années.

Au milieu des années 2000, les possibilités allant de pair avec le développement de l’Internet ont séduit la jeune femme qui a poursuivi des études en hôtellerie orientées vers le numérique, en France. Chloé Freslon a ensuite rejoint l’une des rares agences numériques de l’époque, un choix qui a défini le point de départ d’une carrière web qu’elle n’a jamais quitté depuis. Elle a cumulé des postes de gestionnaires de projets et de produits numériques, et a travaillé avec plusieurs médias québécois. Encore aujourd’hui, elle compose ponctuellement des chroniques pour Québec Science et ICI Première.
Après 10 ans d’évolution dans le milieu et en quête de sens et d’impact, Chloé Freslon réalise un jour qu’elle n’a, bien souvent, travaillé qu’avec des hommes. «J’ai trouvé ça étrange, puis j’ai commencé à me renseigner sur le sujet, indique-t-elle. Je me suis vite rendu compte que c’était un problème global et dommageable pour les femmes, mais aussi pour l’entièreté de la société.»
Fâchée de ce constat, mais déterminée à s’engager dans un projet constructif pour agir face à l’absence de femmes dans le domaine des technologies, elle décide d’écrire des chroniques sur le sujet avec l’approbation de son rédacteur en chef de l’époque, au journal Métro, où elle était responsable des plateformes numériques. «Je voulais montrer que les femmes en tech existaient, mais qu’elles étaient simplement dans l’ombre des hommes», ajoute-t-elle.
Les défis
Au fur et à mesure de ses rencontres avec des femmes dont elle faisait le portrait, Chloé Freslon s’est rendu compte qu’elles faisaient toutes face aux mêmes obstacles. Ses chroniques ont alors progressivement versé dans l’opinion et l’explicatif pour tenter de trouver des solutions. Cette expertise s’est transformée en une idée entrepreneuriale concrète.
«Passer d’une expertise que j’avais développée en écrivant dans les médias à une vraie business, cela a représenté un degré de difficulté que je n’avais pas du tout anticipé, lance l’entrepreneure. Ça a été un peu le parcours du combattant.»

Il a fallu passer par plusieurs étapes incontournables, à savoir étudier un marché, proposer des produits qui y répondent et qui se situent dans une gamme de prix abordables, avec un retour sur investissement presque immédiat pour les clients, se pourvoir d’une marque, et tutti quanti.
Chloé Freslon dit s’être accrochée pour finalement donner naissance à son entreprise en 2019. «J’aurai aimé être prévenue que ça allait être aussi difficile les premiers mois, qu’on me dise qu’il faut juste tougher ça, dévoile-t-elle. Mais c’est souvent dans les moments où on est prêt à laisser tomber que quelque chose nous montre qu’on est sur la bonne voie.»
URelles compte aujourd’hui une panoplie de clients, et notamment des formations destinées aux gestionnaires, des panels et des conseils de carrière. Plusieurs collaboratrices prêtent leur plume au magazine de l’entreprise qui aborde des sujets liés aux femmes en technologie. Chloé Freslon produit et anime également un balado dont la deuxième saison sortira au courant du mois de juin.