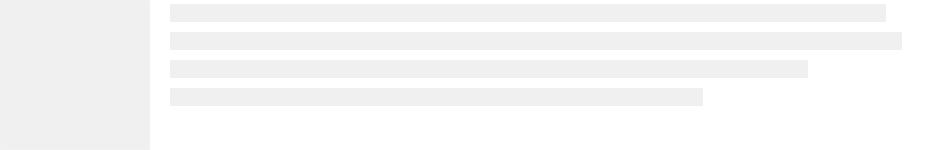Derrière la couverture – Point sur l’industrie du livre au Québec
On les voit passer ponctuellement. Des pourcentages menaçants, des coups de gueule percutants, des appels alarmants à se pencher au plus vite sur les problèmes de l’industrie du livre au Québec. Ce n’est pas une lubie, loin de là: depuis 2012, les ventes annuelles de livres neufs ont connu une baisse de 11%, soit de 74,1 millions de dollars. Mais quand on va plus loin que les chiffres, qu’en est-il vraiment? Les grands – et petits – joueurs tirent quelles impressions du milieu littéraire, dans lequel ils évoluent tous les jours? Tour d’horizon avec divers auteurs, éditeurs, distributeurs, conseillers littéraires, libraires (et alouette).

«Deux éléments clés attirent davantage mon attention, au-delà de l’économie. Tout d’abord, l’émergence de jeunes éditeurs québécois très motivés depuis 10-12 ans. Ce sont des gens extrêmement professionnels: ils font de l’édition de qualité. Ça commence à occuper le territoire littéraire de manière très intéressante. Aussi, le temps de lecture est maintenant happé, grignoté, par tout ce qui permet d’avoir de l’information. Il y a clairement moins de gourmandise envers la lecture.»
Vise-t-il le livre numérique? «Non, vraiment pas! Ça devait être la grande révolution du 21e siècle, et finalement c’est devenu une plate-forme supplémentaire qui évolue en parallèle plutôt qu’un concurrent à l’objet. C’est loin d’être dominant. J’ai l’impression que plusieurs sont toujours sur leur téléphone intelligent. Que ce soit pour lire un courriel, une alerte, une dépêche ou un texto, ça gruge du temps pour lire une œuvre qui peut changer les idées, permettre de visiter un autre univers pour un moment.»
Virage numérique… et médiatique
On le sait, le virage numérique a eu un énorme impact sur le paysage médiatique. «Ça a frappé fort. C’est beaucoup plus difficile. Les médias traditionnels n’ont plus l’impact qu’ils avaient avant, à cause d’une multitude de facteurs. On est en mode érosion en ce moment. On en perd tous les jours. On s’en inquiète, c’est certain. Quand on voit ce qui s’est passé à La Presse par exemple, avec les mises à la retraite volontaires… Moi qui suis toujours à la recherche d’information, je me demande parfois sincèrement où je vais la trouver.»
A-t-il eu tendance à se tourner vers les blogues et webzines pour palier au manque de couverture envers la littérature? «On suit les blogues, oui. J’essaie de mesurer ce que je vois. Il y a environ 10 ou 12 médias en ligne qui font un travail sérieux. Par contre, beaucoup de gens s’improvisent blogueurs, et on ne peut pas donner tout notre lot de livres en service de presse! C’est sans parler du lectorat divisé. Chaque blogue ne rejoint pas tant de personnes. C’est plus difficile de créer un buzz. Il faut que ce soit une excellente critique, avec 8 étoiles sur 5. Il faut travailler vraiment plus fort pour faire connaître un titre.»
Une réalité qui comporte son lot de défis. Malgré une industrie de plus en plus difficile, est-ce que Dimedia a l’impression de tirer son épingle du jeu? «C’est certain que c’est plus instable, mais quelque chose doit fonctionner puisqu’on continue à bien faire notre travail. Je pense qu’on a clairement notre place, même si c’est plus compliqué pour les éditeurs de littérature.»
Qu’est-ce qu’il souhaite à l’industrie du livre au Québec? Serge Théroux marque un silence avant de répondre. «Je ne sais pas. J’espère qu’on aura encore la possibilité de mettre entre les mains des lecteurs des œuvres de qualité, qu’on puisse éviter la pensée unique. C’est le fun les best sellers, mais il y a aussi beaucoup d’autres œuvres qui peuvent mener ailleurs.»
Derrière la couverture – Point sur l’industrie du livre au Québec, un dossier à suivre chaque semaine.