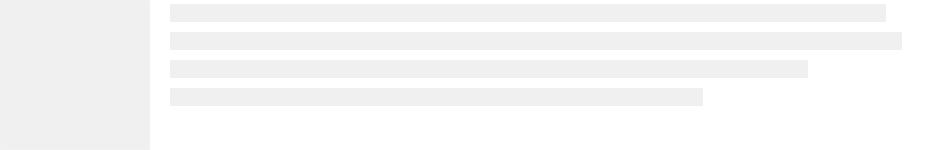Modèle d’affaires: MASSIVart from Extra Caramel on Vimeo.
Pour Philippe Demers, culture et entrepreneuriat font bon ménage. Fondé il y a trois ans, le collectif MASSIVart, incorporé en OBNL en juin 2009, est une entreprise qui a le vent en poupe.
Tout a commencé avec le constat de quelques amis étudiants de l’UQAM que peu d’espaces étaient consacrés à l’art à l’université. Mais plus encore, que les espaces traditionnels de diffusion de l’art provoquaient chez certains plus de bâillements que d’enthousiasme. L’idée est alors venue de promouvoir l’art différemment et dans des lieux inusités.
Bien que le projet n’ait pas été vu au départ comme une entreprise pouvant générer des profits, Philippe et ses partenaires ont quand même démarré sur de bonnes bases: un plan d’affaires, des compétences en gestion de production, et, surtout, une vision à long terme. «Je suis un mélange entre un travailleur culturel et un entrepreneur, répond Philippe lorsqu’on l’interroge sur ses points forts. Je pense que j’ai de bonnes qualités de leadership, une capacité de m’entourer des bonnes personnes. Je pense aussi que je suis un rêveur».
Par rêveur, entendez ambitieux. En effet, le festival Chromatic, principal vecteur de l’activité de l’entreprise, va bientôt traverser l’Atlantique pour rejoindre Paris. L’expansion de l’entreprise ferait presque oublier que, comme beaucoup d’organismes culturels, MASSIVart est autofinancé. «La magie de MASSIVart, c’est qu’on part toujours d’un budget zéro. En trois ans, on n’a eu aucune subvention publique. Tous nos fonds sont privés et viennent de commanditaires, comme Ubisoft ou Solotech. On est rendus experts pour faire des partenariats avec plusieurs types d’organismes.» Selon Philippe, le modèle des subventions gouvernementales pour les entreprises culturelles est non seulement fastidieux mais, en se renouvelant automatiquement après la première fois, il ne stimule pas l’innovation.
Par ailleurs, la culture du don privé n’est pas très développée au Québec. «Ici, on n’est pas habitués à débourser beaucoup d’argent pour s’acheter une œuvre. La culture anglophone est beaucoup plus philanthrope. Ce que je voudrais développer ici au Québec, c’est que le privé s’investisse davantage dans l’art.» Ceux pour qui les OBNL sont des entreprises survivant sur des tiroirs caisses vides pourront donc voir les choses autrement. «La semaine passée, j’ai arrêté tous les contrats que j’avais à droite à gauche pour me concentrer sur l’entreprise et sur nos clients. On n’avait jamais eu ça, des clients; on faisait des événements pour le plaisir. Maintenant, on nous appelle pour des projets!»
Si le mandat de l’entreprise est resté le même, «rendre l’art accessible à un public qui n’est pas habitué aux œuvres d’art», son modèle de financement a, lui, beaucoup changé. À coup de partenariats, d’aides de la part des centres de développement économiques (CDEC) et, peut-être bientôt, des premières vraies subventions gouvernementales, l’entreprise prospère: les heures de travail bénévoles commencent à être rémunérées; des moyens sont investis pour propulser MASSIVart à l’international; et de nouvelles pistes d’autofinancement sont explorée, comme l’acquisition d’un lieu qui pourrait générer d’autres types de revenus.
De tous les conseils que Philippe Demers donne aux entrepreneurs culturels qui veulent se lancer dans ce genre d’aventure, nous en retiendrons un: ne pas avoir peur d’approcher de gros partenaires. «Quand on a approché la SAT, par exemple, on n’avait rien de notre côté. Mais il ne faut pas hésiter à approcher ces gens-là parce que, souvent, ils voient beaucoup plus notre potentiel que ce qu’on pourrait le penser.»
À entendre Philippe, on pourrait reléguer la précarité des OBNL et l’assistanat des entreprises culturelles aux rangs des vieux clichés. Les partenaires privés font figure de mécènes modernes, une vraie opportunité pour les entrepreneurs qui promeuvent l’art. À l’ère des coupures budgétaires dans les domaines culturels, la voie mérite en tout cas d’être explorée.