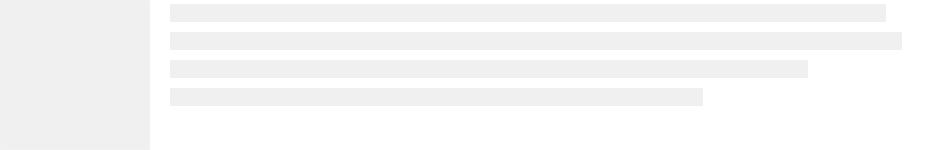Photo: Marie-Claude Hamel – Leitmotiv Studio
Transcription: Marie-Josée Clavet
Entrevue avec François Lacoursière
Vice-président directeur exécutif chez Sid Lee
Historique
Connu autrefois sous le nom de Diesel, c’est en faisant un acronyme qu’ils sont arrivés avec le nom auquel on les associe maintenant. Depuis, il a ouvert un bureau à Amsterdam et à Paris, est reconnu par plusieurs médias et galas comme l’une des agences les plus prometteuses à l’internationale.

Sans vraiment le savoir, vous êtes constamment en train de contempler un concept sur lequel l’agence Sid Lee a mis son empreinte. Pensez à la STM, la SAQ, Tourisme Montréal et Vidéotron pour ne nommer que ceux-là. Dernièrement, il a même réussi à obtenir le compte de la compagnie Adidas Originals pour son image à l’international. Survol d’une agence de pub d’avant-garde.
Quel poste occupez-vous chez Sid Lee et en quoi consiste-t-il?
Je suis vice-président exécutif associé principal. Ça énonce le statut mais pas nécessairement le métier. Je suis responsable de l’unité de stratégies de communication et membre du comité exécutif. D’une part, je fais de la gestion d’entreprise et je prends des décisions plus larges à ce niveau. D’un autre côté, au niveau du produit lui-même, je guide la prise de décisions et les initiatives de communication-marketing.

En quoi Sid Lee, l’agence de publicité de l’année dont tout le monde parle en ce moment, est un collectif?
C’en est un dans deux sens. C’est un collectif d’individus qui a des talents et des expertises extrêmement variés. On essaie d’assembler une équipe créative la plus versatile et diversifiée au monde, parce qu’on pense que les cloisons entre les disciplines sont extrêmement minces, même inexistantes et que la créativité va venir de discussions et d’échanges entre les différents métiers. On vise alors la recherche de solutions plus pertinentes, qui n’ont pas été soulevées avant, avec des discussions entre un ingénieur, un architecte, un designer graphique, un designer industriel ou un stratège.
Quelle différence cela fait-il d’être un collectif? Est-ce une forme juridique d’association?
C’est un collectif d’individus diversifiés, de même qu’un collectif dans la façon de travailler. On essaie également de mettre sur pied un contexte pour favoriser les discussions entre les gens. Du point de vue financier aussi, parce que des fois dans une entreprise avec des expertises particulières, chaque unité est une vache à lait ou un groupe de dépenses ou d’investissements des REER. On veut faire en sorte d’être plus indépendants de la solution au point de vue organisationnel pour pouvoir mettre les bonnes personnes au bon moment et pour réfléchir à la problématique en question. C’est aussi un collectif dans la manière de travailler et dans l’environnement concret.
À l’accueil de vos bureaux, il y a une cafétéria où tout le monde peut se rencontrer, même s’il y a beaucoup d’employés. C’est ce que vous souhaitez, que les gens puissent se rencontrer?
À une certaine époque, il nous fallait une table de pool ou de babyfoot et même un endroit pour faire du yoga. Je pense que ça peut améliorer un certain esprit de collaboration, d’équipe ou même la motivation. Au total, on aime un environnement quand on pense qu’on est mieux ici qu’ailleurs. Les projets doivent être plus inspirants et plus motivants qu’ailleurs. Un lieu peut prescrire les comportements et les valeurs que l’on voudrait voir naître dans un environnement. Par exemple, ça peut sembler trivial, mais si on a une grande table comme ici, ça favorise les rencontres et les conversations, c’est ouvert. Effectivement, il y a du bruit, mais cette énergie qui semble chaotique est si inspirante. Aujourd’hui, c’est plus calme parce qu’il y a une grosse présentation. On provoque des rencontres à l’aide du lieu. Un café, une cafétéria, un lieu pour travailler, c’est nécessaire pour les rencontres informelles de corridor, parce que des fois, en création, on a l’impression que l’on pense tout le temps mais on ne pense jamais. Des fois on ne pense jamais au moment où on s’assoit pour avoir l’idée, mais on pense tout le temps à toute heure du jour. Des fois, c’est dans la salle de bain, dans le corridor, autour d’une table, ou simplement au hasard d’une rencontre dans la journée.
Pourriez-vous me faire un bref historique de Sid Lee. Quel a été le début de tout ça, l’étincelle, d’où est partie l’idée?
Ça a commencé avec Jean-François Bouchard et Philippe Meunier, à la sortie de l’université. Ils avaient le goût de travailler en design et en publicité. Ils sont allés cogner aux portes des employeurs du moment. Un peu déçus de la réception, avec une vision un peu naïve du métier où ils croyaient que les idées étaient bouillonnantes et qu’ils allaient réinventer le monde, ils ne se sont pas fait offrir d’emploi. C’est à ce moment qu’ils se sont dits qu’ils allaient faire la chose par eux-mêmes. Ils ont débuté humblement, notamment avec du design. Ensuite, s’est joint à eux un client, qui est John Sleeman. Il voulait lancer la bière Sleeman au Québec à l’époque, et déjà, intuitivement, il y avait une approche d’honnêteté et de transparence, en admettant que peut-être au moment où les bières québécoises étaient extrêmement performantes, une bière ontarienne avait moins de chances de réussir à se démarquer. Sleeman avait quand même un bon produit, qu’il faisait avec soin, et ils s’est dit : « allons-y comme on est, présentons-nous avec un accent anglais ». John Sleeman était présent lui-même. Il a donc appris le français plus rapidement à cause de cela, en ayant un petit bénéfice collatéral car son français était déjà bon.

Vos bureaux de Paris et d’Amsterdam font partie du même collectif et ça ne se passe donc pas seulement à Montréal?
Ça se passe ailleurs. Pourquoi Amsterdam? Au début on se disait qu’on voulait que ce soit une plateforme et un loft pour du talent. Il y avait beaucoup de jeunes qui commençaient chez Sid Lee, lesquels étaient extrêmement talentueux et avaient le goût de voir le monde, de travailler en Europe et aux États-Unis. On s’est dit pourquoi ne pas faire un petit bureau pour aller travailler de là-bas pour des clients d’ici, et peut-être même des clients de là-bas. Ici, on pense que des grands bureaux ou du grand talent doivent aussi être exposés à du talent d’ailleurs. On faisait le tour du monde, de certaines écoles pour aller recruter du talent, pour avoir un angle différent. Ces gens étaient parfois séduits pas Sid Lee, mais un peu moins par Montréal, la ville et le froid. Ils auraient préféré se retrouver en Californie plutôt qu’à Montréal. On s’est dit que si on avait un bureau à Amsterdam, ils iraient peut-être s’installer là et qu’ensuite ils seraient peut-être séduits par la ville et viendraient s’installer à Montréal.
Est-ce que ce sont des bureaux juste pour dire que vous êtes là ou ils ressemblent à l’environnement que l’on retrouve à Montréal?
Au début, l’intention était de faire un endroit pour que les créatifs et certaines équipes puissent s’installer. Aujourd’hui ce sont des bureaux complets avec des équipes complètes qui servent des clients européens comme Adidas Originals, Eurostar et Ubisoft. Ce sont aussi des rencontres. À Amsterdam, ce sont deux gars que nous avons rencontrés, qui avaient une compatibilité extraordinaire, qui occupent les bureaux. Ils habitaient Amsterdam et avaient le goût d’y vivre. On a fait le calcul par rapport aux coûts et à la facilité de s’y rendre en avion. Ça s’est fait avec un bout de spontanéité, de planification et j’irais même jusqu’à dire d’amour, avec beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Quel est votre background avant d’arriver chez Sid Lee; où avez-vous travaillé, dans quel domaine vous êtes-vous perfectionnés et qui vous a mené ici?
Je suis un publicitaire depuis le début de l’université. Je suis un dropper d’une certaine manière; je n’ai pas réussi à finir mon université. J’étudiais en marketing et en communication au HEC. Il y avait une association étudiante avec un groupe qui servait des PME. Très rapidement, j’ai passé plus de temps là que dans mes cours. Je suis parti en affaires avec d’autres chums d’université en faisant le vœu de ne jamais travailler pour un employeur. Ça a duré deux ans, puis après, l’un de nous a eu une petite famille et voulait avoir plus de revenus parce que ce n’était pas suffisant. Il a trouvé un job avec un salaire que je trouvais, à l’époque, faramineux. On est allé cogner à la porte. J’ai donc commencé à travailler dans les agences de pub. Il y a dix ans, je me suis joint à l’équipe de Sid Lee.
L’année dernière vous avez été nommés « agence de l’année au Canada » et vous avez décroché le contrat mondial d’Adidas Originals. Qu’est ce que ça signifie pour vous de décrocher un contrat pour un brand mondial comme celui-là?
C’est énorme pour nous. À Montréal, être convaincu que notre approche en marketing, en communication, en publicité et en design, de même que la manière dont on s’organise, en se disant que c’est probablement la manière d’approcher la chose et de répondre aux besoins des clients, des marques, de se dire qu’on est capable de le faire mieux que quiconque ailleurs dans le monde, c’est toute une chose que d’y croire soi-même et c’en est une toute autre que d’autres y croient aussi. Des marques qui ont fait le tour, qui ont travaillé avec d’autres, et qui disent que c’est nous qui avons la meilleure équipe, c’est extrêmement motivant, inspirant et encourageant. C’est une année où on a l’impression que le modèle discuté entre nous depuis longtemps est probablement en train de prouver qu’il est approprié aujourd’hui. On le réinventera dans un an ou deux parce qu’on se dit aussi qu’à travers les âges, le pire risque est de ne pas en prendre. On en a pris beaucoup et aujourd’hui il y a des entreprises qui veulent s’associer à ça.

Comment vous différenciez-vous des autres?
Il y a bien des choses semblables. Il y a beaucoup de gens qui disent qu’ils font les choses différemment, mais peu le font vraiment. Je pense qu’avec les vibes, les blogs ça fait beaucoup de gens qui génèrent du contenu, qui ont un point de vue sur quelque chose, qui n’ont pas nécessairement vécu comment le faire, comment ça peut être difficile et si ça donne les résultats escomptés. Mais Adidas Originals, étonnamment, c’est une marque globale qui est pris dans un univers où l’Amérique du Nord et l’Europe ont leur propres perceptions. Montréal est à la jonction de ces deux mondes. Pour les européens, on était enfin des nord américains qui pouvaient comprendre l’Europe, et pour les américains on était enfin des européens qui pouvaient comprendre l’Amérique du Nord. Le fait d’être à Montréal, au milieu de ces cultures latines et anglo-saxonnes, fait en sorte qu’on a un point de vue différent. Il faut en prendre conscience. Sans vouloir paraître condescendant, l’analogie qui me parle c’est qu’il y a le Québec avec le petit et le grand « q ». Il y a le petit qui se définit par ses différences et le grand qui se définit par son universalité, et c’est ce qui fait sa différence. Plus le temps passe, plus on s’accroche à ce qui nous distingue, mais on gagnerait aussi à s’accrocher à ce qui fait qu’on est universel et unique. C’est s’ouvrir sur le monde. Dans l’industrie publicitaire, la communication publicitaire est née un jour parce que M. Bouchard, de BCP, a dit que pour parler aux québécois, il fallait le faire différemment qu’avec le reste du Canada. Ce faisant, on a créé une industrie avec des professionnels locaux spécialisés pour parler à la clientèle locale. C’est différent, mais en même temps, pour une entreprise comme la nôtre, les annonceurs se dirigent aussi vers le Canada anglais ou les États-Unis. Oui, effectivement, le marché québécois est grand, mais on a le goût de faire notre métier et de faire face à plusieurs types de projets. Lorsque l’on construit une île pour empêcher les entreprises de Toronto de venir ici, quand le temps vient d’y sortir, c’est difficile. Mais c’est aussi mental. Une fois le mur mental brisé, qui fait les autres et nous-mêmes croyons en notre talent, en notre approche distincte et pertinente, de même qu’en notre universalité, tout est possible.
Vous avez un modèle d’affaires en tant qu’agence, celle à laquelle les gens commencent à croire après les transitions des dernières années comme la crise économique et celle du média. Il a fallu que les agences pensent à pousser leur pitch différemment pour lancer des idées. Il faut également que les clients apprennent à faire la mise en marché de leurs produits. Comment a commencé cette transition?
Le micro a changé de bord. Avant, c’était ceux qui avaient de l’argent pour être capable d’acheter du média et d’être plus présents qui dominaient. Aujourd’hui le consommateur a le micro. Ça veut donc dire qu’il y a un intermédiaire de moins des fois, et c’est nous.

Comme vous l’avez écrit dans Infopresse, représentez-vous la personne du milieu des bypassée?
Oui, dans le sens où quelqu’un va créer un message au nom du client, ou comme aujourd’hui dans un monde d’influence où des gens ont une opinion et ont le pouvoir de la communiquer et de se faire entendre. Ce qui est positif, c’est que ça oblige les entreprises à être plus honnêtes, transparentes, et à livrer un produit de qualité. Sinon, en deux temps, trois mouvements, c’est rendu publique avec des gens très articulés pour le communiquer, le soutenir et le partager. On pense qu’un produit, un service ou une expérience de qualité a plus de chances d’avoir un succès d’affaires. C’est pourquoi on se rapproche de la création de produits, du côté client, et des lieux où les produits sont vendus, où les clients rencontrent les marques et les vendeurs, parce que c’est la clé. C’est cette expérience qu’on a le goût de communiquer, qu’elle soit positive ou négative, dans les médias sociaux ou ailleurs au quotidien. Le modèle, c’est de se dire qu’il faut créer des expériences qui ont de la valeur au niveau de la satisfaction et de l’expérience identitaire. On peut se servir du récit de voyage pour dire aux autres qui on est et ce que l’on fait. Il y a certaines consommations de produits dont on se sert pour raconter ce que l’on fait au quotidien, les choses qu’on aime, qui nous animent et les valeurs auxquelles on adhère. Les grandes marques qui réussissent dans ce nouvel univers avaient déjà ce sens social. Par exemple les cafés Starbucks; on peut en tenir compte par rapport à la dominance qu’ils ont. Ils ont créé un produit de meilleure qualité, avec plus de choix pour les consommateurs et une atmosphère pour consommer le produit qui était plus appropriée et qui avait plus de générosité. Mais c’est effectivement un produit plus cher.
Est-ce qu’il arrive que des clients viennent vous voir et que vous trouviez que son produit, son service n’est pas assez de qualité et que vous décidiez de ne pas vous occuper de leur campagne?
En même temps, on n’est pas dans le secret des dieux. Ce sont des domaines avec lesquelles on aimerait moins s’associer comme la cigarette et l’armement. On a déjà fait face à ce choix et on a décidé de ne pas y aller. On sait dans les détails comment nos clients s’approvisionnent car on s’informe. Ce serait malhonnête de vous dire qu’à chaque client on fait une recherche exhaustive. De toute façon, on ne pourrait pas le contrôler. Lorsque l’on croit qu’il y a un problème avec le produit, on leur fait comprendre que ce ne serait pas une bonne façon de dépenser leur argent.
Qu’est ce que vous pensez qui s’en vient en 2010? Qu’est-ce que les clients doivent apprendre sur la façon d’aller chercher les consommateurs?
Je leur dirais d’écouter encore plus leurs clients. Ils ont les plateformes technologiques pour le faire. Je leur dirais de faire ça en premier.
Ils ne le faisaient pas avant?
Ils le faisaient, mais pas directement avec les consommateurs; c’était avec des plateformes de recherches et de sondages. Ils écoutaient leurs clients. Les plus efficaces le faisaient en étant sur le plancher, en prenant les commentaires clients. Aujourd’hui, on peut poser des questions afin de savoir ce qu’on fait de bien ou non. Il ne faut pas avoir peur de la réponse. Souvent, les gens ont plus peur de la réponse et des conséquences. Même si on trouve dans une compagnie quelque chose de reprochable, ce n’est pas tant ce qui est reproché que la manière dont va réagir la compagnie qui va avoir de l’impact sur la perception. Il faut avoir conscience que si on fait quelque chose de pas correct, on va être habilité à s’ajuster. Peut-être pas aussi rapidement que le client le souhaiterait, mais on doit tout de même s’assurer qu’on est en train de trouver une façon de le faire et que les choses changent.
Par exemple, pour la campagne de Tourisme Montréal, où l’on voit des bloggeurs et des gens de Montréal presque nus, qui sacrent et qui font le party. C’est ce qui marque les gent de prime abord, parce qu’ils veulent tous paraître beaux. On voit que tout le monde peut être un peu trash.
Le gros changement, c’est que depuis deux années, la communication est aseptisée au niveau du langage, des mots et des images. Dans l’environnement publicitaire traditionnel, il faut se rendre compte qu’aujourd’hui, ça ne représente pas la réalité, mais plutôt que ça nuit plus que ça aide. Les gens ne sont pas dupes. Derrière un écart de langage, un petit « tabarnac » à gauche ou à droite, ou une image dans laquelle les gens ne sont pas la vision qu’on voudrait avoir, il y a le mot « aspirationnel ». Dans notre métier; on dit souvent que les gens voudraient être comme cette personne qui est bien mise, qui démontre tous les signes d’une réussite sociale, mais aujourd’hui on est plus dans l’être que dans le paraître. Il faut éviter de mettre autant d’énergie à paraître et en prendre beaucoup plus à être et avoir du contenu. La beauté, c’est que des clients comme Vidéotron, à l’époque, n’aurait pas passé de communiqué comme quoi un réseau de téléphonie cellulaire 3G a été mis en place. Il n’aurait pas tenté d’expliquer la technologie mis derrière, ni payé le contenu ou le média pour le faire parce que ça n’intéressait pas autant de gens. Ça a changé. Parce qu’il y a des gens que ça intéresse, on va le faire. Le coût pour le produire n’est pas le même qu’avant et on n’est plus dans l’impératif de porter pour que ça plaise à plus de gens possible. Je pense que tout le monde va y trouver son compte.
Qu’est-ce qui se passe pour Sid Lee en 2010, entre autre au niveau du développement?
C’est une grosse année. La culture ici, c’est qu’on se projette souvent en avant, on pense à 2010, 2012, 2013. On se rappelle qu’on est au pied de l’Everest. On aime la reconnaissance, le fait que les projets que nous avons pour nos clients sont appréciés. En même temps, on est intéressé par le prochain projet, le prochain défi. En même temps il faut aussi reconnaître qu’on nous a reconnus, au Canada anglais, comme agence de l’année. Il faut en faire beaucoup au Québec pour qu’ils nous reconnaissent, je dois dire, dans notre métier.
Même de nos jours?
Encore un peu parce qu’on est moins dans le radar, parce que le matériel produit ici n’est pas visible. C’est seulement une question de visibilité.
Est-ce que Montréal est perçue comme une ville créative à travers le monde, tant dans la culture que dans les autres domaines? Avez-vous beaucoup voyagé?
On voyage beaucoup. La première décision qu’on a prise en désirant avoir des contrats à l’extérieur de Montréal, c’est de voyager nous même. Si l’on veut prétendre être plus global, on doit l’être personnellement. On a pris l’avion, on s’est promené, on est allé en Europe, en Amérique du Sud, pour voir comment ça se passe dans les villes, pour voir les gens et le matériel produit. On peut le voir sur Internet mais ce n’est jamais comme se rendre sur place et avoir les références au niveau de l’hôtellerie, du retail, ainsi que ce que les entreprises font et les produits mis en place. On a beaucoup voyagé et quand on rencontrait des gens on leur parlait de Montréal, on disait qu’elle était à la jonction de deux cultures et qu’il y a beaucoup de créativité. Personne n’a résisté à la chose et tout le monde était prêt à recevoir ça. S’il y avait quelque chose qu’ils connaissaient de Montréal, c’était le fait qu’on y parle français, ce qui apportait peut-être une vision différente dans une mare d’anglophones en Amérique du Nord. Oui, on reconnaissait la créativité et le dynamisme que l’on retrouve à Montréal et on peut partir de là, plutôt que d’essayer de convaincre les gens que c’est ça. Je pense que les gens y croient plus qu’on y croit nous même!